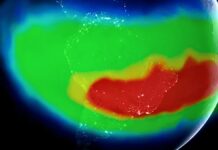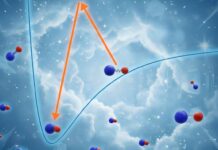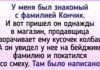Une figurine en argile remarquablement préservée, découverte en Israël, offre un aperçu sans précédent des croyances et de l’expression artistique du peuple natoufien qui vivait il y a 12 000 ans. La petite sculpture représente une figure humaine avec un oiseau positionné de manière à suggérer un acte intime, soulevant des questions sur les premières perceptions humaines de la sexualité, de la spiritualité et de la relation entre les humains et les animaux.
La découverte et sa signification
Les archéologues ont découvert la figurine à Nahal Ein Gev II, un site archéologique près de la mer de Galilée. La pièce, fabriquée à partir d’un seul bloc d’argile puis fragmentée en trois morceaux, mesure un peu moins de quatre centimètres de haut. Ce qui le rend exceptionnel est la clarté de la représentation : une forme humaine avec un oiseau posé sur le dos dans une position suggestive. Il ne s’agit pas simplement d’une représentation artistique ; il s’agit de la première représentation connue d’une figure humaine en Asie du Sud-Ouest, antérieure aux sociétés agricoles établies.
Les Natoufiens étaient une culture de chasseurs-cueilleurs sédentaires qui occupait les actuels Israël, Palestine, Jordanie, Liban et Syrie il y a entre 15 000 et 11 500 ans. Leurs colonies, bien qu’elles ne soient pas entièrement agricoles, présentent les premiers signes d’habitation permanente. La découverte de cette figurine suggère que leur culture était bien plus complexe qu’on ne le pensait auparavant.
Ce que représente la figurine
La sculpture montre une figure humaine, probablement féminine étant donné la zone triangulaire incisée représentant la région pubienne et les empreintes ovales symétriques près du visage suggérant des seins. Sur le dos de l’humain se trouve un oiseau, identifié par les os d’animaux trouvés sur le site comme étant probablement une oie. La position de l’oiseau, avec les ailes déployées vers l’arrière, suggère un acte d’accouplement.
Si certaines interprétations proposent que la figurine représente un chasseur transportant un oiseau tué, les chercheurs privilégient une explication mythologique : la représentation d’une oie s’accouplant avec une femelle accroupie. De telles images d’unions homme-animal ne sont pas rares dans les mythes ultérieurs, et cette figurine en constitue le premier exemple connu.
Implications pour comprendre les premières croyances
La figurine remet en question les hypothèses sur le paysage spirituel et culturel de la période pré-néolithique. Les Natoufiens, vivant avant l’avènement de l’agriculture sédentaire, s’adonnaient déjà à des représentations symboliques complexes. L’acte de créer cette sculpture suggère un désir émergent de représenter une imagerie féminine, potentiellement liée au rôle croissant des femmes dans les pratiques spirituelles.
De plus, une empreinte digitale partielle trouvée sur la figurine peut indiquer qu’elle a été sculptée par une femme. Basée sur des comparaisons de densité de crête avec des empreintes digitales modernes, l’empreinte suggère une paternité féminine, bien que cela reste provisoire.
Le contexte plus large
La figurine a été découverte dans une zone du site utilisée pour l’inhumation, aux côtés d’autres dépôts uniques, notamment une sépulture d’enfant et une cache de dents humaines. Cela suggère que le lieu avait une signification rituelle. Cette découverte intervient à un moment où notre compréhension des cultures pré-néolithiques évolue rapidement.
Les Natoufiens étaient à l’aube de la révolution néolithique, la transition vers une agriculture sédentaire et une domestication. Cette figurine suggère que, même avant ce changement, ils créaient déjà des images complexes et exprimaient potentiellement des croyances animistes. C’est une fenêtre sur un monde où les frontières entre les humains et les animaux étaient plus fluides et où le domaine spirituel était activement représenté dans l’art.
La figurine n’est pas simplement un artefact ; c’est un témoignage de la fascination humaine durable pour le monde naturel et les mystères de la création. Cela nous met au défi de reconsidérer nos hypothèses sur les origines de la croyance et l’évolution de la conscience humaine.